Les propos du Christ sur les enfants sont les plus révolutionnaires de l’Évangile
Interview de Sylvia Marty publiée le 29/04/2011, Le Monde des Religions
Pourquoi appelle-t-on cruauté le fait de frapper un animal, agression le fait de frapper un adulte et éducation le fait de frapper un enfant? Douze pays européens ont voté une loi interdisant toute violence éducative y compris la fessée, la gifle etc. En France le sujet agace ou au mieux prête à sourire. Rencontre avec Olivier Maurel, fondateur de l’observatoire sur la violence éducative ordinaire.
La correction comme moyen éducatif est transmis de génération en génération. Elle est ancrée dans notre culture et admise comme normale. La fondation pour l’enfance vient de lancer une campagne anti-gifle et fessée. Pourquoi parle-t-on de la maltraitance et laisse-t-on de côté la violence éducative ordinaire ?
Parce que le seuil de tolérance à la violence subie par les enfants de la part de leurs parents nous est en quelque sorte fixé par l’éducation que nous avons reçue. Ce que nous appelons maltraitance, c’est le niveau de violence que, dans notre société, on ne tolère plus, par exemple frapper un enfant à coups de bâton ou de ceinture. Mais des gifles ou des fessées, nous en avons presque tous reçu de la part de nos parents que nous aimions et nous avons donc été persuadés très tôt qu’il était normal de frapper les enfants de cette façon. Ceux qui ont subi des bastonnades dans les nombreuses sociétés où c’est la coutume (et c’était aussi la coutume chez nous jusqu’au XIXe siècle) trouvent aussi la bastonnade tout à fait normale et ne songent pas plus à la remettre en question que nous ne songeons à contester la gifle ou la fessée.
Quel fut l’élément déclencheur de votre prise de conscience sur la violence éducative ordinaire?
La lecture du livre C’est pour ton bien, d’Alice Miller. Je m’interrogeais sur la violence humaine depuis mon enfance où j’ai connu la guerre et les bombardements. Pourquoi les hommes s’entretuent-ils comme ils le font ? Or, Alice Miller montre que la plus grande partie de la violence humaine, y compris les violences collectives, sociales ou politiques, a pour origine les violences subies dans l’enfance: abus sexuels, abandon, manque d’amour et, beaucoup plus général, presque universel, l’emploi de la violence pour ‘corriger’ les enfants.
Pourquoi avoir fondé l’observatoire sur la violence éducative ordinaire?
J’ai fondé cet observatoire pour essayer de faire prendre conscience à l’opinion publique de l’importance quantitative et qualitative de la violence éducative, cette forme de violence que nous avons tendance à ne pas voir, à minimiser (on ne parle que de ‘petites tapes sur les couches’, de ‘petites tapes sur la main’…), à justifier, à considérer comme indispensable. Dans le livre que je suis en train de terminer, je montre que cette cécité sélective est poussée à un tel point que sur plus de cent auteurs, chercheurs, philosophes, psychanalystes, historiens qui ont écrit ces dernières années des livres dont le titre annonce qu’ils vont traiter de la violence, 90% d’entre eux ne disent pas un mot, vraiment pas un mot, de la violence éducative, et le plus souvent même pas de la maltraitance.
La fondation pour l’enfance vient de lancer une campagne anti-gifles et fessées. Qu’en pensez-vous?
J’en ai été très heureux. Et je suis allé participer mercredi à Paris au lancement de cette campagne. J’ai trouvé que le film était très intelligemment axé sur le fait que la violence éducative est un phénomène de reproduction de génération en génération, et il ne m’a pas paru culpabilisant pour les parents. Selon de récentes recherches, les coups reçus par les enfants provoquent des lésions et entravent leur développement .
Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière?
Quand un enfant reçoit des coups, son organisme réagit comme réagit l’organisme de tous les mammifères face à une agression. Dès la perception de la menace ou du coup, il sécrète en quantité des hormones qu’on appelle hormones du stress qui sont destinées à lui permettre de fuir ou de se défendre. Ces hormones ont pour effet d’accélérer les battements du cœur pour envoyer davantage de sang dans les membres et rendre la fuite ou la défense plus efficace. De plus, par une sorte de principe d’économie d’énergie, l’organisme désactive toutes les fonctions qui ne sont pas indispensables à la fuite ou à la défense, par exemple la digestion, la croissance et le système immunitaire.
Si l’enfant peut fuir ou se défendre, au bout d’un moment, l’équilibre se rétablit dans le corps, les hormones du stress s’évacuent et les fonctions stoppées se remettent en activité. Mais un enfant frappé ne peut ni fuir ni se défendre. A ce moment-là, comme l’avait montré Alain Resnais dans son film Mon oncle d’Amérique, les hormones du stress deviennent toxiques et attaquent les organes, notamment le système digestif et certaines parties du cerveau. Elles détruisent les neurones. Et d’autre part, comme la violence éducative est souvent répétitive, le système immunitaire à force d’être désactivé et réactivé, est altéré dans son fonctionnement et ne défend plus aussi bien l’organisme. Les enfants sont souvent d’autant plus vulnérables aux maladies qu’ils ont été davantage frappés.
Dans Matthieu, 19:15, Jésus dit « si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. (…) Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspende à son cou une meule de moulin, et qu’on le jette au fond de la mer. » Pourquoi cette parole du Christ n’a-t-elle pas été comprise par les chrétiens?
Je n’hésite pas à dire que les propos du Christ sur les enfants sont les plus révolutionnaires de l’Evangile. Je ne leur connais aucun équivalent dans aucune religion. Ils sont pour moi une des preuves que Jésus n’était pas seulement un homme. Alice Miller pensait que s’il avait pu les prononcer, c’est qu’il avait été exceptionnellement aimé, protégé et respecté par ses parents, comme le disent d’ailleurs les Evangiles qui parlent de son enfance.Quand Jésus enfant fait ce que nous appellerions une fugue, et qui plus est une fugue de trois jours, pour discuter avec les prêtres dans le temple, non seulement ses parents ne le frappent pas, mais ils lui disent simplement leur incompréhension et leur angoisse.
Malheureusement, ces propos sur les enfants n’ont jamais été compris par les Eglises chrétiennes comme ils auraient dû l’être. Quand Jésus nous présente les enfants comme des modèles à suivre pour entrer au Royaume des cieux, il est évident qu’il ne nous les présente pas comme des êtres qu’il faudrait corriger, et à plus forte raison à coups de bâton! On ne corrige pas des modèles, on les suit, on les imite. Mais la société du temps de Jésus, comme la nôtre il y a peu, était une société où, pour suivre la douzaine de proverbes bibliques qui traitent de l’éducation, on battait les enfants pour faire sortir la « folie » qui était en eux (Proverbes, 22, 15: La folie est au cœur de l’enfant; le fouet bien appliqué l’en délivre.)
Les disciples de Jésus avaient donc été élevés de cette façon par des parents qu’ils respectaient plus que tout. Il leur était donc pratiquement impossible d’imaginer que les paroles de Jésus pouvaient s’appliquer à cette méthode d’éducation. De même, quand Jésus dit à propos de quelqu’un qui ‘scandalise’ un enfant : « Mieux vaudrait pour lui se voir passer une pierre à moudre et être précipité dans la mer que de scandaliser un seul de ces petits », il est évident que le fait de donner à un enfant l’exemple de la violence en le battant et, qui plus est, l’exemple de la violence d’un être fort sur l’être le plus faible et sans défense qui soit, est une façon de le scandaliser.
Mais les anciens enfants qu’étaient les apôtres éprouvaient certainement à l’égard de leurs parents un attachement si viscéral qu’il leur était impossible de comprendre le sens de ces paroles. Résultat: l’Eglise n’a jamais remis en question la façon traditionnelle d’élever les enfants à coups de bâton, que ce soit dans les familles ou dans les écoles, et les institutions religieuses ont souvent été des enfers pour les enfants. On en a eu encore récemment des exemples avec les établissements irlandais tenus par des religieuses qui battaient comme plâtre les jeunes filles qu’on leur confiait.
L’incompréhension des premiers chrétiens à l’égard des paroles de Jésus sur les enfants apparaît de façon évidente dans le premier livre des Confessions de saint Augustin. Il en arrive même à corriger à sa manière le sens de la phrase du Christ: « A leurs pareils le Royaume des cieux » qui, d’après lui, voudrait dire non pas que les enfants sont innocents, ce qui est quasi-incompréhensible pour des adultes qui trouvent normal d’avoir été battus, mais qu’ils sont humbles, au sens étymologiques du mot: proches de l’humus, de la terre. Je suis pour ma part convaincu que c’est l’incompréhension de ces paroles de Jésus qui a fait que le christianisme a été en échec face au problème de la violence. Prêcher l’amour du prochain ne signifiait plus rien, ne pouvait avoir aucune efficacité, quand, parallèlement, on élevait les unes après les autres les générations d’enfants de manière à les rendre viscéralement violents par le traitement qu’on leur faisait subir.
Et malheureusement l’Eglise jusqu’à présent n’a pas bougé d’un iota sur ce point. Le Catéchisme de l’Eglise catholique, approuvé par le Pape en 1992, dit ceci à propos des parents: « En sachant reconnaître devant eux leurs propres défauts, ils seront mieux à même de les guider et de les corriger. » Qui aime son fils lui prodigue des verges, qui corrige son fils en tirera profit » (Si 30, 1-2).
Quelle est la position des différentes religions par rapport aux châtiments corporels infligés aux enfants?
La première religion qui ait de façon assez radicale remis en question les châtiments corporels est une religion issue de l’islam: la religion Bahaï, née en Iran au début du XIXe siècle, et dont le fondateur s’est opposé à la méthode utilisée couramment dans les écoles coraniques. Certains Quakers ont aussi dénoncé la pratique des punitions corporelles infligées aux enfants. Mais le plus souvent les religions chrétiennes ont au contraire refusé qu’on les interdise lorsque les Etats, à l’incitation du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, ont commencé à voter des lois d’interdiction.
Je crois que les méthodistes, aux Etats-Unis, ont pris position contre les punitions corporelles. Même chose pour le Conseil Œcuménique des Eglises (protestantes) en Afrique. Bizarrement, c’est dans la religion musulmane où pourtant la pratique des punitions corporelles est très intense, qu’on a vu des philosophes (par exemple Miskawayh, philosophe du Xe siècle, ou encore Ibn Khaldûn, historien du XIVe siècle) analyser avec le plus de perspicacité les effets nocifs des punitions corporelles.
Que répondez-vous aux parents, ces anciens enfants, qui disent « moi aussi j’ai reçu des gifles et des fessée. Ça ne m’a pas traumatisé » ?
Il est vrai que chez beaucoup de gens les effets des fessées ou des gifles sont atténués par l’affection que leurs parents leur ont donnée par ailleurs, ou/et par le fait que les punitions n’ont pas été données arbitrairement mais d’une manière qui leur a paru « juste ». Malheureusement, il y a toujours un effet secondaire qui demeure et qui montre que ces personnes ont subi en quelque sorte une lésion du sens moral, c’est que les parents qui disent cela trouvent normal :
- Que l’on frappe les enfants
- Qu’un être grand et fort frappe un être petit et faible.
Or, ces deux faits sont en contradiction avec le principe le plus élémentaire de la morale qu’ils cherchent en général à inculquer à leurs enfants: ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu’on te fasse. Et en général ils ne voient même pas la contradiction entre ce principe et ce qu’ils pratiquent et recommandent. Cette forme de cécité est bien la marque d’un traumatisme, mais non ressenti comme tel. Alice Miller a intitulé un de ses livres publié d’abord en allemand : « Tu ne t’apercevras de rien ». C’est un des effets les plus redoutables de la violence éducative.
Selon vous, les Français sont-ils prêts à changer leur approche de « la bonne fessée qui n’a jamais fait de mal à personne » ?
Il y a une évolution, surtout chez les jeunes parents, mais elle est très lente et les résistances sont très fortes. Elles sont dues en grande partie à l’attachement que nous avons à l’égard de nos parents. Il nous est très difficile de remettre en cause ce qu’ils nous ont fait subir.
Faut-il absolument légiférer pour faire évoluer les mentalités?
C’est précisément l’attachement que nous avons à l’égard de nos parents qui fait qu’il est indispensable de légiférer. Nos parents font partie de notre psychisme. Quand nous frappons nos enfants, en un sens, ce sont eux qui frappent à travers nous (ce qu’exprime très bien le film de la fondation pour l’enfance). Tant qu’une autorité supérieure à celle des parents ne dit pas clairement qu’il est inacceptable de frapper les enfants et qu’ils doivent être respectés comme on respecte les adultes et les personnes âgées, l’usage ne changera pas, ou très lentement comme il change depuis le début du XIXe siècle.
Or, vu la nécessité où nous nous trouvons, notamment avec la crise climatique, d’effectuer des changements profonds dans notre comportement, il est urgent de permettre aux nouvelles générations de disposer de toutes leurs facultés affectives, intellectuelles et morales pour affronter les situations vers lesquelles nous allons. Et la violence éducative altère ces facultés. J’ajoute que dans un grand nombre de pays où les enfants sont encore frappés à coups de bâton ou punis d’autres manières aussi violentes, la situation est bien pire que chez nous et qu’il est donc urgent de donner l’exemple du renoncement à cette méthode d’éducation.
Pour aller plus loin :
La fessée, Olivier Maurel, éditions La Plage 2007 (réédition)
Oui, la nature humaine est bonne, éditions Robert Laffont 2009
Œdipe et Laos. Dialogue sur l’origine de la violence, éditions L’Harmattan
J’ai tout essayé, Isabelle Filliozat, éditions Jean-Claude Lattès
http://www.oveo.org/ (OVEO)
http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/les-propos-du-christ-sur-les-enfants-sont-les-plus-revolutionnaires-de-l-evangile-29-04-2011-1480_111.php
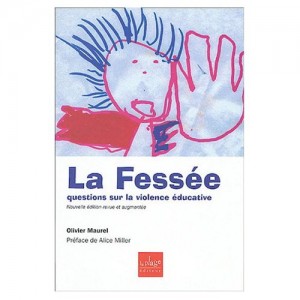
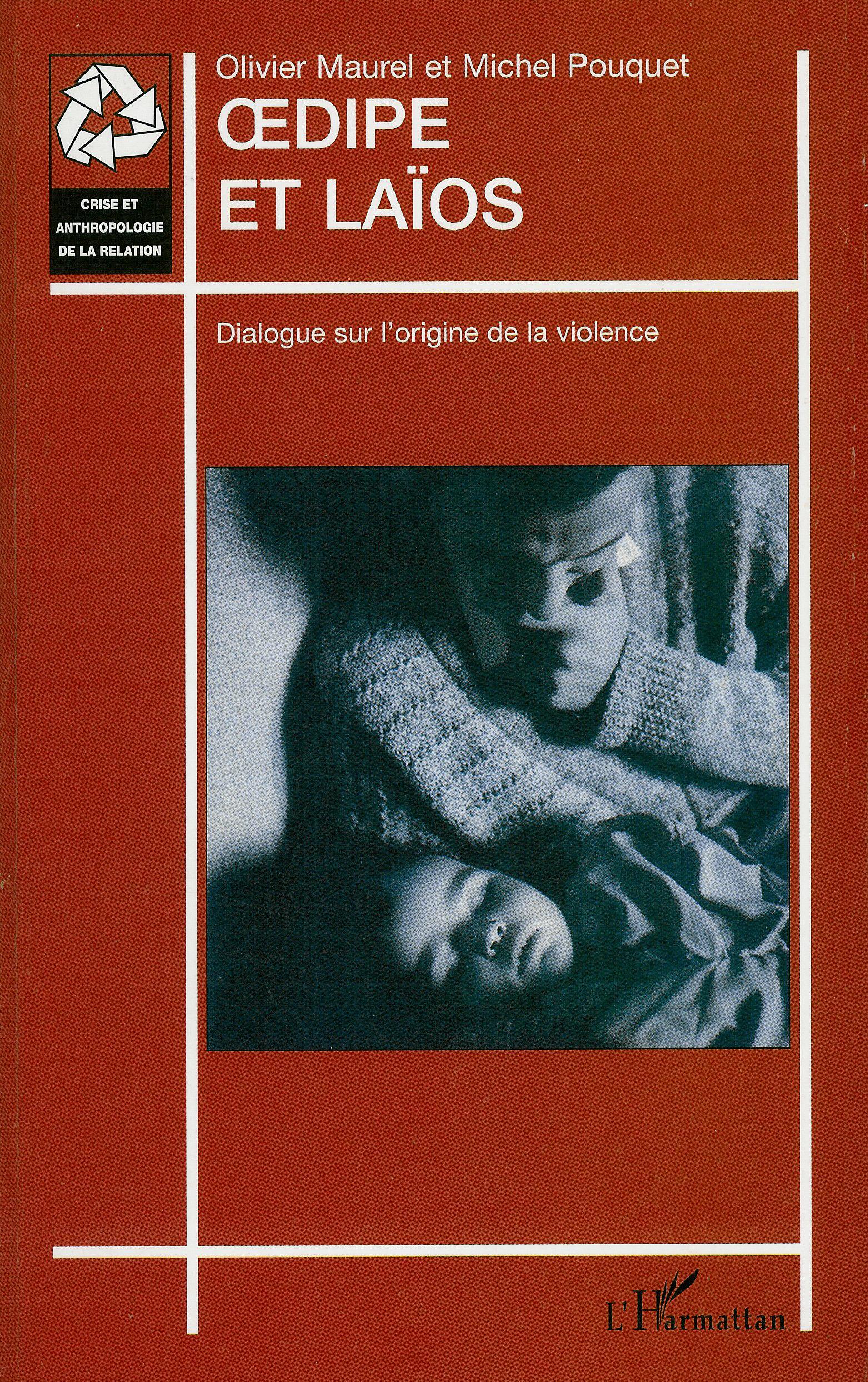
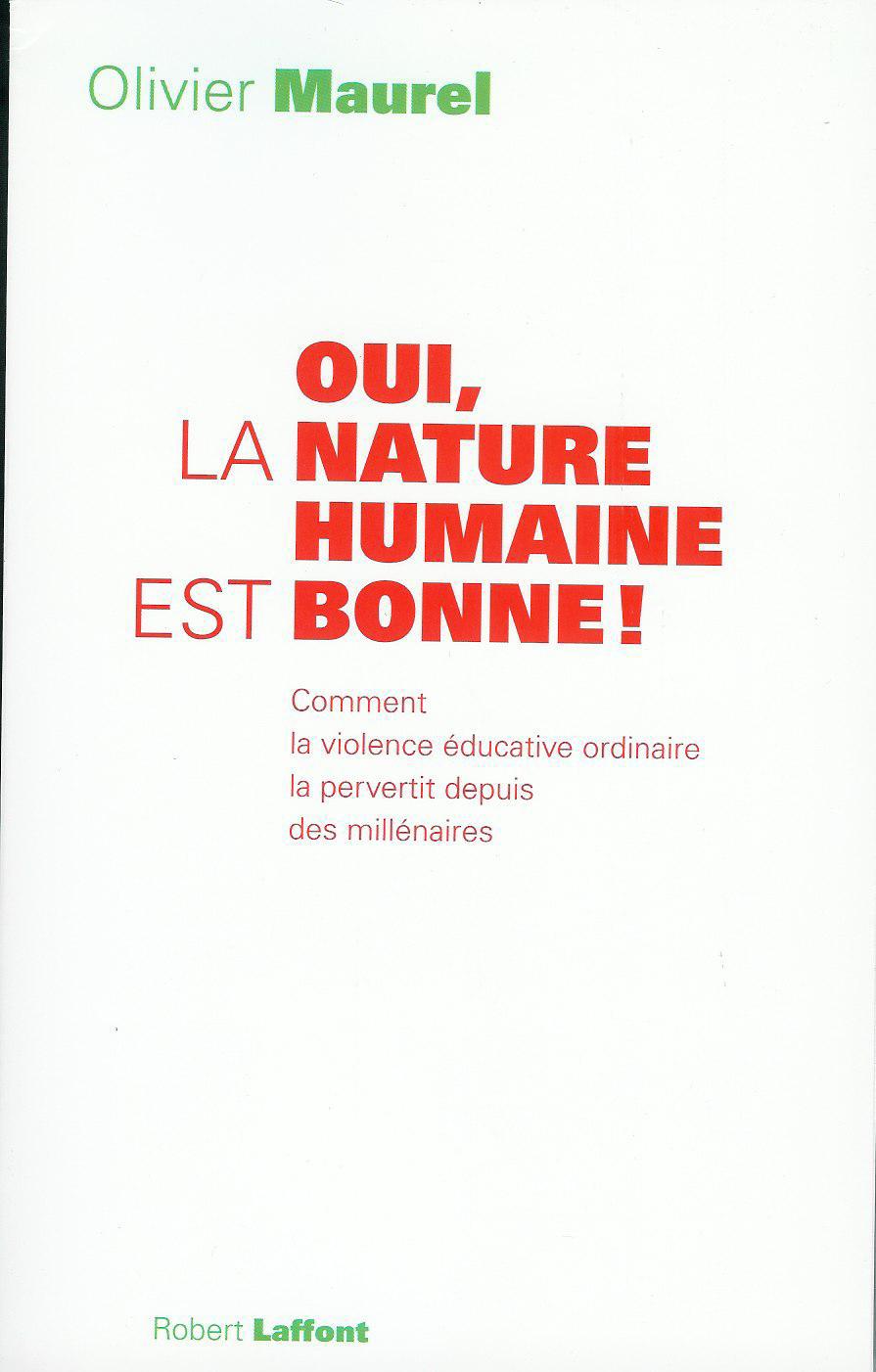
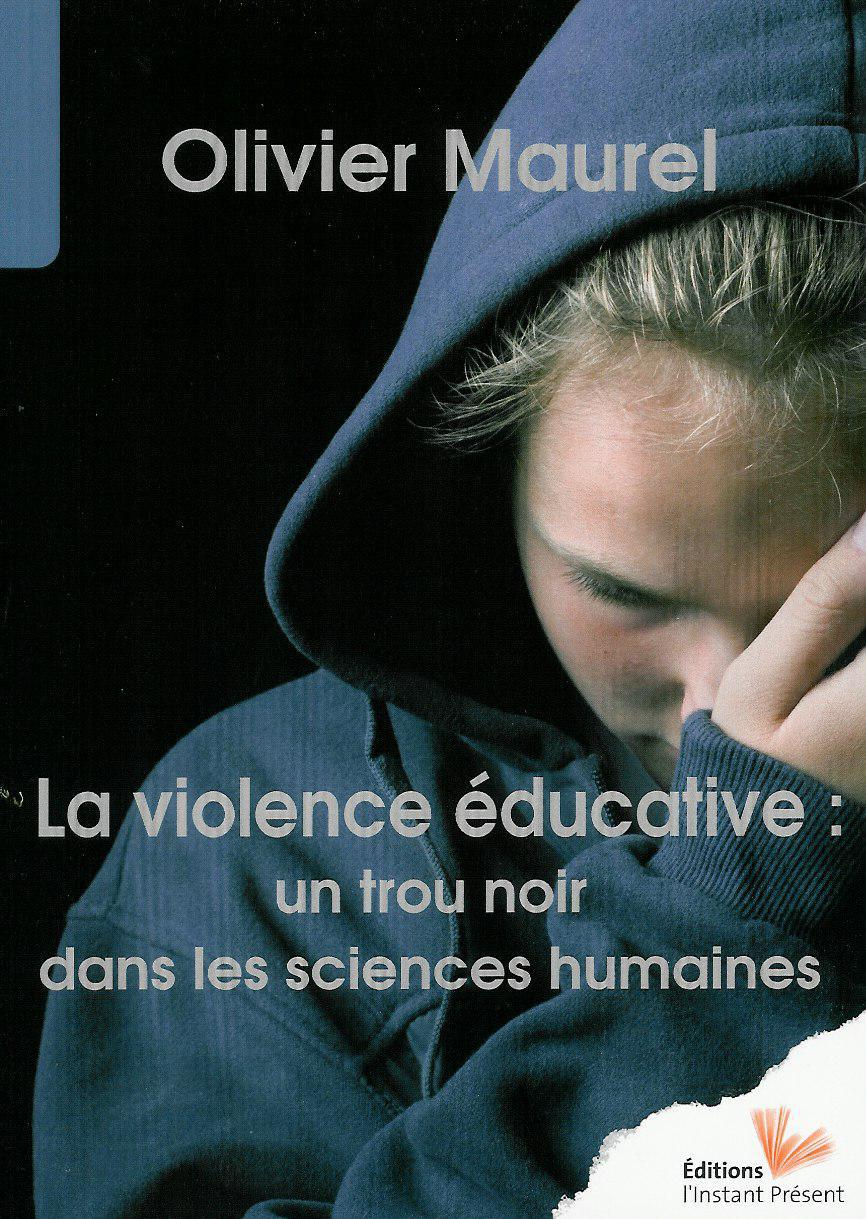
Commentaires récents