ai de vrai, c’est ce qu’a écrit, en première page du Monde des livres du 18 juin 2009, la romancière et essayiste Nancy Huston à propos de mon nouveau livre paru le 22 janvier 2009 :
OUI, LA NATURE HUMAINE EST BONNE ! Comment la violence éducative la pervertit depuis des millénaires
(Robert Laffont).Voici le texte complet de son article :
Qui châtie bien fait beaucoup de mal…
Le titre (qui n’est pas de l’auteur) fait frémir. La thèse (que résume le sous-titre) fait pouffer. C’est tellement énorme, se dit-on, que ce doit être simpliste, donc faux. Nous voilà au coeur du problème : l’espèce humaine est cette étrange espèce qui aime dire et entendre dire du mal d’elle-même, croire sa nature mauvaise plutôt que bonne.
Olivier Maurel, auteur d’un précédent ouvrage sur la fessée, explore ici tous les tenants et aboutissants du thème de la violence éducative. Une fois que l’on en a entamé la lecture, on cesse de pouffer et on écoute. On se souvient, peut-être, de l’enfant qu’on a été, et des coups que l’on a reçus. On apprend que, partout dans le monde, « 80 à 90 % des enfants sont soumis à la violence éducative pratiquée dans leur pays ».
Ainsi, la première leçon d’éthique inculquée aux petits humains est-elle une leçon paradoxale : le fort a le droit de faire mal au faible, serait-ce pour lui apprendre à ne jamais faire mal à plus faible que soi ! Le mépris des enfants suscite, chez les enfants méprisés devenus adultes, le mépris des enfants. D’où un refus de prendre au sérieux leur souffrance, et une tendance à la perpétuer, dans un des plus vieux cercles vicieux du monde.
Boussole intérieure perturbée
Le cerveau de l’enfant est justement en train de se former. Secoué, choqué, déstabilisé par la violence, incapable de critiquer ceux qui la lui infligent, dont il dépend entièrement pour sa survie, l’enfant tourne son stress contre lui-même, avec des résultats désastreux pour sa santé physique et mentale. Sa boussole intérieure est perturbée. Ses pensées se scindent de ses émotions et il apprend à ne plus éprouver de la compassion, d’abord pour lui-même, ensuite pour les autres.
En une fresque magistrale, Maurel passe en revue la philosophie, les religions, les traités d’éducation et la littérature, de l’Antiquité à nos jours. Il montre comment les trois monothéismes ont élaboré le concept d’un Dieu paternel et punissant, modèle et justification des pères réels châtiant leurs enfants. Les garçons sont plus frappés que les filles, précisément pour qu’ils ne deviennent pas des « femmelettes ».
Alors que Jésus incarnait à cet égard une attitude révolutionnaire (« Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n’entrerez pas au royaume des cieux »), saint Augustin – après s’être amèrement plaint des châtiments subis pendant sa scolarité – formulera le dogme du péché originel qui fera de chaque humain à la naissance un être mauvais, devant être contraint par la force à emprunter la voie du Bien.
Le chapitre le plus lumineux du livre est peut-être celui qui rapproche ce dogme chrétien de celui, psychanalytique, du complexe d’Œdipe. En décidant de ne plus croire aux abus sexuels subis par ses patient(e)s, Freud opère un retournement spectaculaire : alors que les vrais fautifs étaient les pères, le coupable désigné sera l’enfant. Ce ne sont pas les adultes qui violent ou maltraitent leurs rejetons, mais ceux-ci, « pervers polymorphes », qui rêvent d’inceste et de parricide. D’où, pour Freud, cette certitude : « Il faut que l’éducation inhibe, interdise, réprime. »
Impressionnants pères sévères
Les conséquences de cette misopédie généralisée sont ahurissantes mais prévisibles. Un garçon battu aura plus de chances de battre sa femme et ses enfants ; une fille battue, de devenir une femme battue et de battre ses enfants. Ont été des enfants gravement maltraités, non seulement la quasi-totalité des délinquants et des criminels, mais aussi les hommes politiques s’arrimant à des idéologies virulentes et désignant à leur tour des boucs émissaires à éliminer, de Milosevic à Hitler, Staline ou Mao. On n’aime pas entendre cela. On est tellement impressionné par ces « pères sévères » que la seule idée de chercher à expliquer leurs méfaits par leur enfance nous frustre de notre colère. On est tellement fasciné par l’horreur d’Auschwitz qu’on préfère ou bien la sacraliser en décrétant qu’elle est incompréhensible, qu’ »il n’y a pas de pourquoi » – ou, au contraire, la banaliser en prétendant que tout un chacun est susceptible de devenir bourreau.
Si on lit le livre d’Olivier Maurel, on ne pourra plus raisonner ainsi. On apprendra, d’une part, que toutes les populations s’étant livrées à des génocides avaient reçu une éducation basée sur la discipline, la punition, l’obéissance aveugle, et, d’autre part, que les individus ayant refusé de collaborer au déploiement du mal extrême, ayant préservé leur compassion (les « Justes » par exemple), avaient vécu, petits, dans la tendresse et le respect de leur entourage.
Certes, malgré la puissance des arguments de Maurel et la pléthore de ses preuves, plusieurs questions restent sans réponse. Quid, par exemple, des parents permissifs, dont les enfants peuvent être ultraviolents ? Quid de la violence comme preuve de liberté, chère à l’Homme du souterrain de Dostoïevski ? Quid, surtout, des autres causes de la violence ? Car celle-ci, pour les êtres fabulateurs que nous sommes, est une source inépuisable d’histoires, d’intrigues, de rebondissements et d’effets inattendus. Bien plus que la création (qui, elle, est toujours lente et laborieuse, toujours partielle), la destruction – instantanée, spectaculaire – nous donne un accès rapide et euphorisant à la toute-puissance divine.
Oui la nature humaine est bonne ! soulève un sacré lièvre. Il faut surmonter ses résistances, le lire et le faire lire. C’est un de ces rares ouvrages qui, bien compris, pourrait infléchir l’Histoire. »Un de ces rares ouvrages qui, bien compris, pourrait infléchir l’Histoire ».
Vrai de vrai, c’est ce qu’a écrit, en première page du Monde des livres du 18 juin 2009, la romancière et essayiste Nancy Huston à propos de mon nouveau livre paru le 22 janvier 2009 :
OUI, LA NATURE HUMAINE EST BONNE ! Comment la violence éducative la pervertit depuis des millénaires
(Robert Laffont).
Voici le texte complet de son article :
Qui châtie bien fait beaucoup de mal…
Le titre (qui n’est pas de l’auteur) fait frémir. La thèse (que résume le sous-titre) fait pouffer. C’est tellement énorme, se dit-on, que ce doit être simpliste, donc faux. Nous voilà au coeur du problème : l’espèce humaine est cette étrange espèce qui aime dire et entendre dire du mal d’elle-même, croire sa nature mauvaise plutôt que bonne.
Olivier Maurel, auteur d’un précédent ouvrage sur la fessée, explore ici tous les tenants et aboutissants du thème de la violence éducative. Une fois que l’on en a entamé la lecture, on cesse de pouffer et on écoute. On se souvient, peut-être, de l’enfant qu’on a été, et des coups que l’on a reçus. On apprend que, partout dans le monde, « 80 à 90 % des enfants sont soumis à la violence éducative pratiquée dans leur pays ».
Ainsi, la première leçon d’éthique inculquée aux petits humains est-elle une leçon paradoxale : le fort a le droit de faire mal au faible, serait-ce pour lui apprendre à ne jamais faire mal à plus faible que soi ! Le mépris des enfants suscite, chez les enfants méprisés devenus adultes, le mépris des enfants. D’où un refus de prendre au sérieux leur souffrance, et une tendance à la perpétuer, dans un des plus vieux cercles vicieux du monde.
Boussole intérieure perturbée
Le cerveau de l’enfant est justement en train de se former. Secoué, choqué, déstabilisé par la violence, incapable de critiquer ceux qui la lui infligent, dont il dépend entièrement pour sa survie, l’enfant tourne son stress contre lui-même, avec des résultats désastreux pour sa santé physique et mentale. Sa boussole intérieure est perturbée. Ses pensées se scindent de ses émotions et il apprend à ne plus éprouver de la compassion, d’abord pour lui-même, ensuite pour les autres.
En une fresque magistrale, Maurel passe en revue la philosophie, les religions, les traités d’éducation et la littérature, de l’Antiquité à nos jours. Il montre comment les trois monothéismes ont élaboré le concept d’un Dieu paternel et punissant, modèle et justification des pères réels châtiant leurs enfants. Les garçons sont plus frappés que les filles, précisément pour qu’ils ne deviennent pas des « femmelettes ».
Alors que Jésus incarnait à cet égard une attitude révolutionnaire (« Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n’entrerez pas au royaume des cieux »), saint Augustin – après s’être amèrement plaint des châtiments subis pendant sa scolarité – formulera le dogme du péché originel qui fera de chaque humain à la naissance un être mauvais, devant être contraint par la force à emprunter la voie du Bien.
Le chapitre le plus lumineux du livre est peut-être celui qui rapproche ce dogme chrétien de celui, psychanalytique, du complexe d’Œdipe. En décidant de ne plus croire aux abus sexuels subis par ses patient(e)s, Freud opère un retournement spectaculaire : alors que les vrais fautifs étaient les pères, le coupable désigné sera l’enfant. Ce ne sont pas les adultes qui violent ou maltraitent leurs rejetons, mais ceux-ci, « pervers polymorphes », qui rêvent d’inceste et de parricide. D’où, pour Freud, cette certitude : « Il faut que l’éducation inhibe, interdise, réprime. »
Impressionnants pères sévères
Les conséquences de cette misopédie généralisée sont ahurissantes mais prévisibles. Un garçon battu aura plus de chances de battre sa femme et ses enfants ; une fille battue, de devenir une femme battue et de battre ses enfants. Ont été des enfants gravement maltraités, non seulement la quasi-totalité des délinquants et des criminels, mais aussi les hommes politiques s’arrimant à des idéologies virulentes et désignant à leur tour des boucs émissaires à éliminer, de Milosevic à Hitler, Staline ou Mao. On n’aime pas entendre cela. On est tellement impressionné par ces « pères sévères » que la seule idée de chercher à expliquer leurs méfaits par leur enfance nous frustre de notre colère. On est tellement fasciné par l’horreur d’Auschwitz qu’on préfère ou bien la sacraliser en décrétant qu’elle est incompréhensible, qu’ »il n’y a pas de pourquoi » – ou, au contraire, la banaliser en prétendant que tout un chacun est susceptible de devenir bourreau.
Si on lit le livre d’Olivier Maurel, on ne pourra plus raisonner ainsi. On apprendra, d’une part, que toutes les populations s’étant livrées à des génocides avaient reçu une éducation basée sur la discipline, la punition, l’obéissance aveugle, et, d’autre part, que les individus ayant refusé de collaborer au déploiement du mal extrême, ayant préservé leur compassion (les « Justes » par exemple), avaient vécu, petits, dans la tendresse et le respect de leur entourage.
Certes, malgré la puissance des arguments de Maurel et la pléthore de ses preuves, plusieurs questions restent sans réponse. Quid, par exemple, des parents permissifs, dont les enfants peuvent être ultraviolents ? Quid de la violence comme preuve de liberté, chère à l’Homme du souterrain de Dostoïevski ? Quid, surtout, des autres causes de la violence ? Car celle-ci, pour les êtres fabulateurs que nous sommes, est une source inépuisable d’histoires, d’intrigues, de rebondissements et d’effets inattendus. Bien plus que la création (qui, elle, est toujours lente et laborieuse, toujours partielle), la destruction – instantanée, spectaculaire – nous donne un accès rapide et euphorisant à la toute-puissance divine.
Oui la nature humaine est bonne ! soulève un sacré lièvre. Il faut surmonter ses résistances, le lire et le faire lire. C’est un de ces rares ouvrages qui, bien compris, pourrait infléchir l’Histoire.
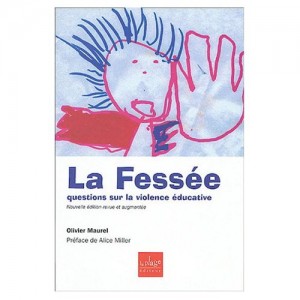
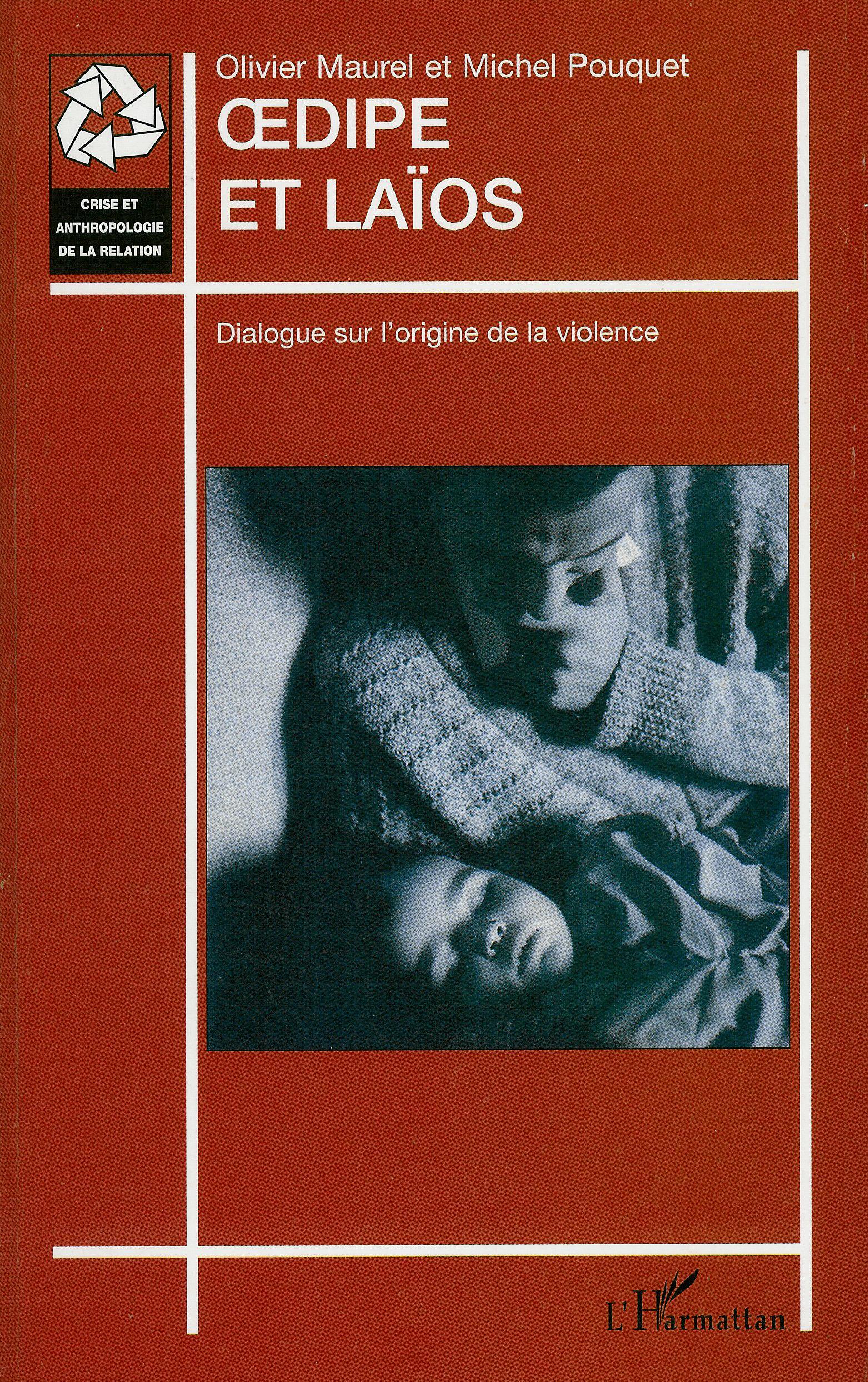
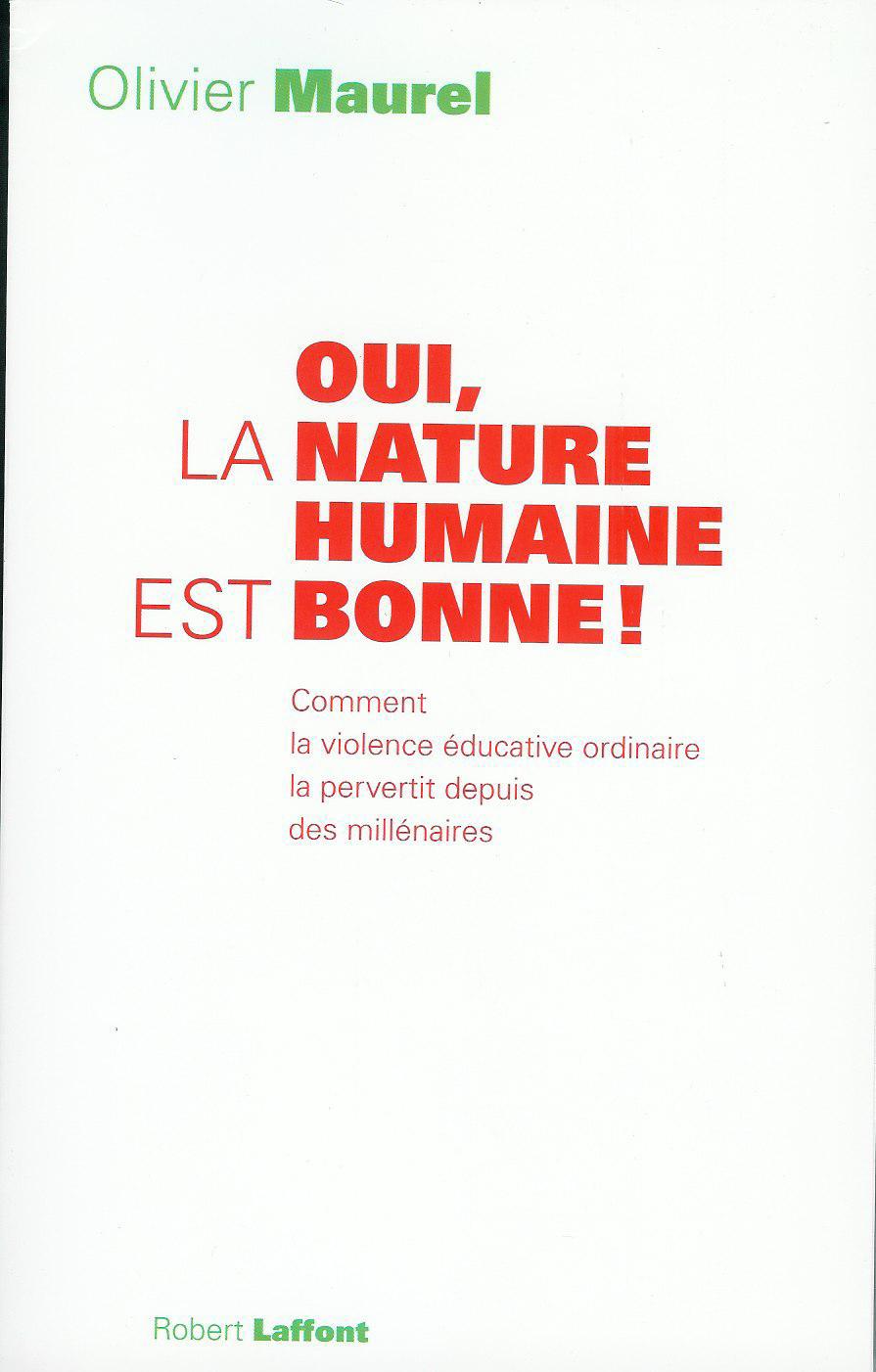
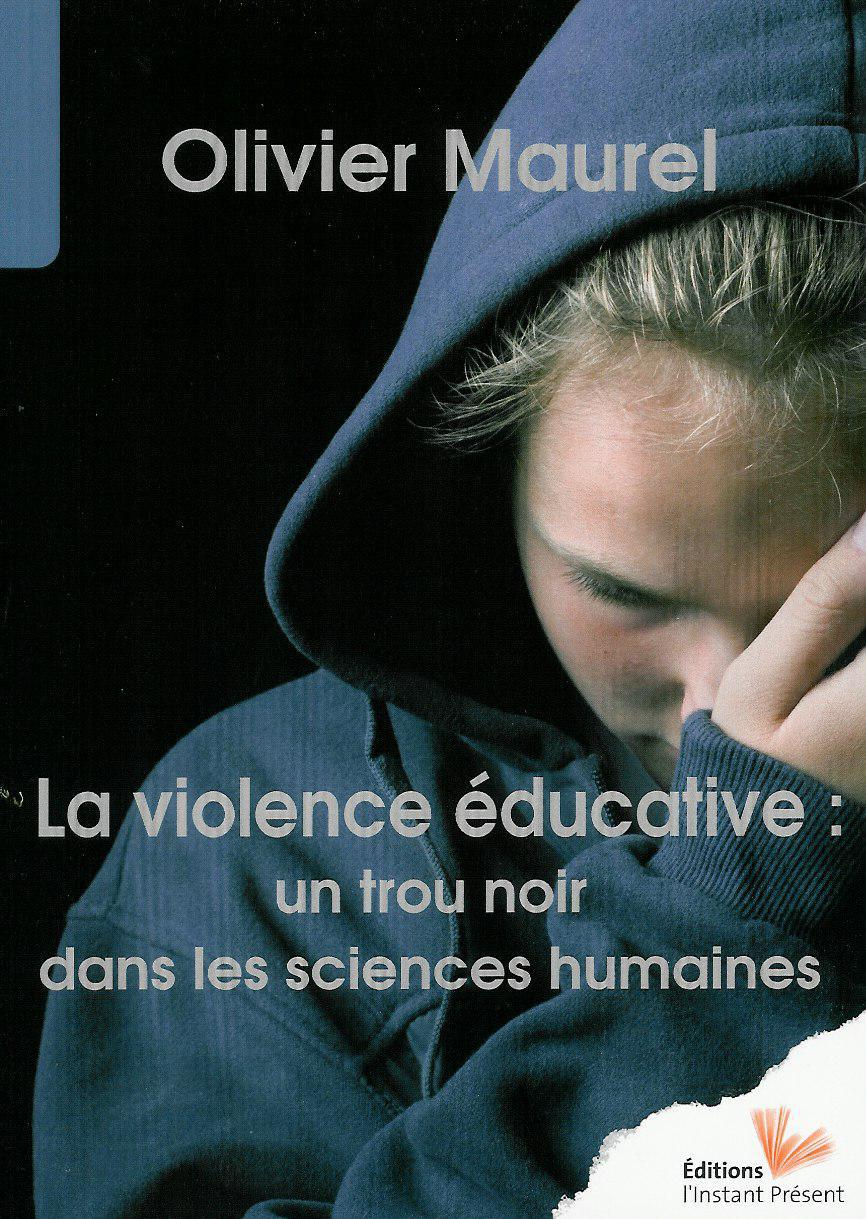
Commentaires récents